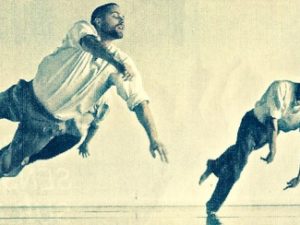CADRE VISIBLE ET CADRE CACHÉ
On parle souvent du cadre en supervision, mais il est une dimension très importante et rarement perçue comme telle. En dehors du cadre contractuel ou explicite, celui dont tout le monde parle, il est un cadre spécifique de la psychothérapie que j’appellerai ici le cadre caché ou implicite. J’en ai largement parlé ailleurs, dans mes séminaires et mon livre sur l’accompagnement des personnes psychotiques ordinaires car il constitue un des éléments majeurs du chaudron.
Ou
UN APPEAU POUR L’INCONSCIENT…
Mots-clés : psychothérapie, cadre, contrat, chaudron, transfert-contre-transfert, ici maintenant, sorties du cadre, répétition, ambivalence, neutralité bienveillante, les Sirènes.
Les praticiens que j’accompagne ignorent à quel point ils m’ont aidé à élaborer, clarifier, tester, valider les outils conceptuels que j’expose ici. Qu’ils en soient remerciés.
Les noms (cryptés) sont ceux des héros des vignettes. Qu’ils soient remerciés ici de m’avoir autorisé à 1 utiliser leur travail.
CADRE VISIBLE ET CADRE CACHÉ
On parle souvent du cadre en supervision, mais il est une dimension très importante et rarement perçue comme telle. En dehors du cadre contractuel ou explicite, celui dont tout le monde parle, il est un cadre spécifique de la psychothérapie que j’appellerai ici le cadre caché ou implicite. J’en ai largement parlé ailleurs, dans mes séminaires et mon livre sur l’accompagnement des personnes psychotiques ordinaires car il constitue un des éléments majeurs du chaudron.
Les deux cadres s’emboîtent l’un dans l’autre et forment un dispositif indispensable pour mener une psychothérapie au sens strict, attentive à l’inconscient et à ses mécanismes essentiels, le transfert, la résistance, les systèmes de loyauté.
Ma conception de la psychothérapie étant centrale pour mon propos, je reprends dans un encadré en fin d’article quelques points essentiels sur la question. Les propositions que je fais ici ne demandent qu’à être validées, nuancées ou infirmées par la pratique.
LE CHIRURGIEN ET LE PSYCHOTHÉRAPEUTE
Le cadre qui règle la régularité, la périodicité, la durée et le tarif des séances, la gestion des rendez-vous et leur annulation, est un contrat privé de type commercial qui relève de la règlementation des prestations de services, comme le billet de cinéma. Les termes en sont explicites, les partenaires s’engagent à le respecter et connaissent les conséquences de son non-respect. Ce cadre n’est pas celui du thérapeute mais le contrat qui règle leur 2 relation.
Par ailleurs tout ce qui relève de la responsabilité pénale et civile et du code de déontologie professionnelle (confidentialité compte tenu des dérogations légales, abstention de geste sexuel ou violent, obligation de formation continue) s’impose naturellement au praticien. Ces règles concernent tous les professionnels d’aide à la personne (travailleurs sociaux, aidants, éducateurs, coachs, praticiens de TCC, etc) aussi bien que les psychothérapeutes, quelle que soit leur approche. Elles n’ont rien de spécifique et ne font pas partie du contrat privé, elles sont de fait, mais il n’est pas inutile de les rappeler.
Le champ opératoire délimite clairement le lieu où le chirurgien portera son attention et son a c t i o n . L e r a p p r o c h e m e n t a v e c le psychothérapeute est frappant : tous deux
doivent être totalement présents dans l’ici et maintenant isolé par le cadre, ici le champ opératoire, là le cadre caché du praticien. Le cadre impose au chirurgien de suivre strictement les règles de son art, au psychothérapeute, il demande une perception et une écoute non ordinaires.
Mais le contrat entre consultant et psychothérapeute est différents des contrats commerciaux. Doit-on régler le rendez-vous qu’on annule chez le médecin, le psychiatre ou le kiné ? La règle s’impose quand il s’agit d’une psychothérapie parce que le contrat témoigne de l’engagement du consultant à se rendre à un rendez-vous avec lui-même, ce qui change tout. Il ouvre sur la dimension implicite de la valeur que le consultant se donne à lui-même, à son insu, tellement il s’est habitué à être une personne de deuxième choix. Dès la porte franchie, le cadre caché rappelle au praticien qu’il a rendez-vous avec l’insu du consultant et le sien et l’engage dans une forme d’écoute particulière de ce qui est là. C’est d’être présent à cet implicite qu’engage le cadre caché, mais il peut difficilement fonctionner si on ne pose pas clairement le contrat explicite, c’est-à-dire le contrat d’engagement. Comme en témoigne la vignette n°1.
1ère VIGNETTE : ils s’entendent pour (ne pas) commencer une psychothérapie
Personnages : Noël le thérapeute, Toussaint le consultant, travail en groupe Noël amène Toussaint, son consultant, en supervision pour une histoire de bouteilles. Il est surpris le jour où Toussaint, toujours si régulier et ponctuel, annule son rendez-vous à la dernière minute. Noël se rend compte qu’il ne lui a jamais signifié la règle classique que tout rendez-vous annulé moins de 48h à l’avance est dû. Il le fait à cette occasion. La fois suivante son consultant vient avec deux bonnes bouteilles produites par le vignoble familial. Qu’en fait Noël ? – Je les ai bues bien sûr, du bon vin comme ça, on ne va pas s’en priver, non ! D’ailleurs il a dit que c’était pour la séance due.
– Il te devait quelque chose ?
– euh… ben… je ne peux pas lui faire ça, il veut me faire plaisir, et j’aime le bon vin, pourquoi s’en priver ? Le cadre doit-il nous priver de tout ? (Un tout lourd de plaisirs interdits)
Le contrat n’avait pas été posé et ne peut s’appliquer de façon rétro-active, principe juridique élémentaire. Toussaint ne doit rien mais il fait mine de l’ignorer et propose à Noël d’en faire de même. Déplaçant la dette il fait de Noël son obligé. Le cadeau non dû accepté, plus de risque de confrontation. Plus de conflit, que du plaisir et de la corruption.
Le cadre doit-il nous priver de tout ? se demande Noël comme s’il parlait d’une contrainte imposée par ses maîtres et que, leur dos tourné, il va s’empresser d’oublier. Si elle n’a d’autre sens, pourquoi s’obliger à la formuler ? Toussaint veut faire plaisir à Noël, Noël ne veut pas contrarier Toussaint. Où est le mal ? Rien à redire sauf que… Si Toussaint avait eu connaissance de la règle, il aurait dû payer la séance. Noël n’aurait eu aucune raison de l’en remercier et ils auraient eu à travailler l’annulation, peut-être un évitement de ce qui commençait à bouillir chez Toussaint à mesure qu’approchait la séance.
Désormais pas de possibilité pour lui de voir ce qu’il s’est fait en annulant. Y a-t-il encore un pilote dans le train de la psychothérapie ? Y a-t-il même un passager ? Encoche minuscule dans le contrat du manuel scolaire, mais grosse entaille dans le tissage psychothérapique.
Noël était en difficulté depuis le début. Toussaint, un homme agréable, affable, gentil, de 37 ans, était pourtant aussi insaisissable pour Noël qu’il lui donnait envie de le suivre, entre cépages et ésotérisme, dans des itinéraires compliqués que Noël trouvait à son goût. Les raisons pour lesquelles Toussaint est venu donnent le vertige : réussir à gérer ses addictions (alcool, sexe), être sûr qu’il n’est pas fou, parvenir à s’engager avec sa compagne, devenir un homme, un vrai. Noël n’arrive pas à faire respecter ce qu’il appelle le cadre. Quand Toussaint affirme que ses nombreuses activités ne lui permettent pas de venir en séance plus d’une fois par mois, il ajoute « et encore c’est pour toi que je viendrai. » Le monde à l’envers. Noël accepte.
Si le travail pour lequel Toussaint le paie n’est pas une psychothérapie mais des conversations de soutien ou de conseil, pourquoi pas ? Mais Noël se veut psychothérapeute et il souhaite y voir clair. Aurait-il sinon apporté cette situation en supervision ?
S’il avait eu conscience du cadre caché, il aurait examiné s’il était prêt à accompagner Toussaint dans le non dit et l’insu. Il aurait perçu leur facilité à contourner le cadre comme une complicité pour ne pas faire le travail pour lequel l’un vient et l’autre se fait payer, pour lequel l’un annule son rendez-vous et l’autre ne veut pas y regarder de plus près. On a vu les enjeux que Toussaint met dans la thérapie. Il ne connaît pas le chemin, il fait comme il peut avec ses désirs et ses peurs car il ne s’agit de rien moins que de rencontrer son âme mais il s’en défausse et évite le rendez-vous avec lui-même. Le psychothérapeute est là pour assurer qu’on ne quitte pas le chemin de cette âme en souffrance ce qui demande du temps et du respect.
Noël a succombé à la tentation de ne pas emprunter ce chemin. Il a évité de suivre son cadre professionnel en ne posant pas clairement le cadre contractuel et en le noyant dans une complicité joyeuse. Gentil n’a qu’un oeil, dit un vieux proverbe, en étant gentil on ferme un oeil sur ce qui pourrait gêner, voire fâcher. Deux gentils, chacun avec un seul oeil… On ne risque pas d’y voir grand chose. Pas de cadre contractuel, pas de cadre implicite, pas de psychothérapie.
Une psychothérapie nécessite pour fonctionner un dispositif qui l’isole de la réalité ordinaire et installe une relation disposée à accueillir tous les niveaux de la réalité mentale. C’est ce qu’assure le cadre caché ou implicite comme le montre la vignette n°2, si on y est attentif.
VIGNETTE N°2 Dans un salon de thé
Véra la psychothérapeute, Amandine la consultante, supervision individuelle Amandine est une retraitée très séduisante, apprêtée avec soin, bien habillée, bijoux et accessoires de choix. Véra est captivée par le récit de ses journées occupées du matin au soir, entre relations mondaines et activités de dame patronnesse.
Tout irait pour le mieux dans la séance si tout à coup ne surgissait une phrase venant court circuiter l’attention de Véra et brouiller son cerveau. Elle ne sait pas quoi en faire, il se produit comme un bug, qui l’amène en supervision aujourd’hui. Elle en est tellement saisie que les mots se sont gravés dans son esprit. Une fois c’était « je n’ai plus envie de vivre ». Une autre fois « j’ai le plus grand mal à me lever le matin. » Difficile à comprendre alors qu’Amandine vit tant de choses excitantes tout au long de la journée. Les bras m’en tombent quand j’entends ça. Je ne sais plus quoi dire… dit Véra.
Autre moment de flottement : Amandine vient à chaque séance avec une brassée de rêves riches et récurrents. Véra a beau être rompue à l’analyse des rêves, elle n’arrive à rien éclaircir. Nuit après nuit, Amandine cherche l’entrée d’une maison qu’elle sait être la sienne. Quand par chance elle y parvient, elle ne trouve pas son appartement. Elle sait que c’est au troisième étage mais l’ascenseur, un drôle d’habitacle sans porte, tout décati dans cette belle maison bourgeoise, ne l’y conduit jamais. Véra ne trouve aucun fil à tirer, aucun début de sens. Que se passe-t-il qui mette ainsi Véra dans la paralysie. Que chantent les Sirènes ?
Je reprends les fameuses phrases en ajoutant que ce sont quand même des paroles qui ne détonnent généralement pas dans un cabinet de psychothérapie… Véra semble étonnée. Pour elle, ces mots ne sont pas à leur place dans sa rencontre avec Amandine. C’est bien simple, elle ne comprend pas d’où peuvent venir ces mots chez cette femme dont la vie est si riche, qui n’a pas un moment à elle de la journée.
Clairement Véra se trouve dans un salon de thé avec une connaissance qu’elle admire, qui reçoit estime et louange de tous et qui, à la surprise générale, oublierait toute décence et laisserait apparaître le fond de son âme en détresse et la noirceur de ses tourments. Déplacé ! Je hasarde au fond, comme si Amandine était chez une psychothérapeute… À ces mots Véra prend conscience qu’elle avait elle-même, et depuis longtemps, déserté cette place. Qu’elle était sortie avec Amandine et que l’intérêt de leur rencontre était devenu le récit que sa consultante pouvait faire des apparences de sa vie et non ce qui l’amenait réellement au cabinet.
Heureusement pour Véra que des failles s’ouvrent dans le discours d’Amandine qui jurent assez avec le reste pour que Véra se réveille, en se demandant d’un coup où elle se trouve et ce qu’elle fait avec cette femme en ce lieu. Retour à l’ici et maintenant.
Réveillée, la thérapeute reprendra peut-être sa place, entendant ce que dit Amandine, qu’elle ne veut pas ou plus vivre (cette vie d’apparence n’est que survie palliative, comment vivre en vrai) ou peut-être que quelqu’un, quelque chose, quelque part doit mourir, etc. En somme un aperçu non exhaustif des déclinaisons dont une telle phrase peut faire l’objet. Et que disent les tentatives répétées en rêve de trouver sa maison, d’y entrer et de ne jamais réussir à accéder au lieu qui est le sien dans cette maison ? Autrement dit… au rendez-vous avec elle-même.
Séduite par la richesse de la vie sociale d’Amandine, Véra a oublié qu’en franchissant la porte de son cabinet avec sa consultante, elle entrait avec elle dans une réalité différente de la vie ordinaire menant sur des dimensions cachées de notre existence, plutôt les ténèbres nocturnes que les spots du jour. Elle n’a pas su dans un premier temps profiter de la protection que la bulle lui proposait vis-à-vis de la réalité sociale extérieure. Amandine semblait presque le savoir mieux qu’elle.
Le cadre implicite, en créant une bulle temporelle, met de même à distance la perception habituelle du temps. Il ouvre à une dimension temporelle qui s’écarte de l’écoulement linéaire du temps biographique et qui met à mal la causalité historique (tel événement produit tel effet) pour se rapprocher du patchwork onirique. Deux vignettes vont illustrer cette particularité et la difficulté des praticiens à l’accueillir.
VIGNETTES 3 ET 4 : plonger dans le passé… pour éviter le présent ? Alice, Édith, praticiennes, travail en groupe
Alice est troublée par sa consultante, Ophélie, une jeune fille de 17 ans, habitée par l’idée d’organiser un suicide assisté à l’étranger. Alice cherche ce qui pourrait expliquer cette idée fixe. Enfin Ophélie parle de son enfance, elle était déjà harcelée en primaire, ses parents absents, pris par leur travail. Alice s’écrie « Ah, ces parents, même pas présents, ils ne l’ont pas défendue, pas protégée, tout s’explique ! ». Et dans un éclair de grande clairvoyance elle ajoute « toujours ma passion de comprendre, d’expliquer, de juger ! » Tout est dit. Ce faisant elle a quitté par cette sortie la thérapeute prise dans l’inconfort paralysant de l’obsession d’Ophélie. Voit-elle encore Ophélie venue se poser dans le cadre, ici, en face d’elle, venue soigner son enfance martyrisée ?
Alice comprendra-t-elle que que la vraie question est celle de l’attachement d’Ophélie à ses parents à travers l’attachement à ce passé et que se soigner sera difficile à accepter pour Ophélie. Parce que car ce serait être infidèle à la mémoire qui fixe l’enfant dans ce souvenir, tel que les uns et les autres, les silences forcés, les émotions interdites, les personnes à protéger l’ont forgé et tel que l’ont confirmé les événements de sa vie. Les praticiens sont souvent piégés par le récit biographique et se projettent dans le passé des causes ou des événements au lieu d’accompagner maintenant le mouvement et les émotions qui émergent, d’où qu’ils viennent, appelés par une image, un mot, un nom, dans l’espace spatio-temporel de la relation actuelle.
Lors d’une supervision de groupe, Édith introduit son thème par la lassitude d’une qui devrait soulager toute la misère du monde, murmurant « « ça ne va pas suffire » Elle a reçu Blanche deux fois seulement et elle est écrasée par le poids de tout ce que Blanche rapporte, à commencer par une tentative de suicide à 6 ans. Édith s’est vue couchée par terre, comme submergée par une vague dépressive venue de loin. Va-t-elle retourner dans l’enfance de Blanche pour effacer ses malheurs. Non ! Dit-elle avec force pour ajouter mais j’en ai le fantasme.
La tâche est au-dessus de ses forces, l’appât puissant de l’incompétence et/ou de la culpabilité qu’affectionnent de tendre les Sirènes l’a accrochée. « Les bras m’en tombent ». D’autant que Blanche vient l’achever en disant j’ai besoin de vous. Édith n’en peut plus de ces appels à voler au secours d’une personne qu’elle croit en perdition ou dans une détresse infinie, convaincue que personne d’autre ici ne peut le faire. Fausse empathie qui enferme la praticienne et fait la litière des sorties du cadre, dans ce cas particulier une bascule dans le passé de Blanche.
J’ai besoin de vous – voilà que cette phrase, reprise en supervision, permet de renverser le mouvement. Blanche ne demande pas à être consolée, à trouver une mère, un père, une famille d’accueil, une pleureuse, non, elle a besoin d’une professionnelle pour faire ce qu’elle a à faire. Dans la détresse on a besoin de l’essentiel pour tenir le coup, pour survivre, il n’est plus question de ménager les autres… Blanche est une personne brillante et volontaire qui a beaucoup de ressources, elle est adulte, elle a tout traversé jusque-là, est venu le temps de s’occuper de l’enfant meurtrie et résiliente.
Peut-être l’avalanche de souffrances dont elle a d’abord submergé Édith était-elle un test pour vérifier si la praticienne qu’elle consultait était prête à rester à ses côtés dans la traversée de la thérapie. Test posé par le pilote inconscient de sa destinée.
LES FONDAMENTAUX DU CADRE THÉRAPEUTIQUE
Le cadre contractuel (ou explicite) et le cadre psychothérapique (ou implicite ou caché) s’appuient l’un sur l’autre. Sans le cadre caché, la transgression du contrat serait à considérer comme une infraction à sanctionner, dont il faudrait éviter la répétition, comme dans le cadre de la loi ou d’un contrat commercial habituel. Mais le jeu du consultant avec le contrat parle des aléas de son rendez-vous avec lui-même. Tout en découle. Il choisit d’y aller ou pas, il recule, il arrête, il revient.
Les éléments constitutifs du cadre implicite sont une bulle temporo-spatiale (l’ici et maintenant, un espace-temps enclos dans des limites précises) et une relation créée par un double mouvement : celui du consultant, qui ignore ce qui rend sa démarche incontournable, celui du praticien qui ignore où va le conduire cette rencontre. Ainsi s’installe dans les limites posées une réalité originale qui n’obéit pas aux principes de la réalité sociale habituelle et se rapproche de ceux du rêve quant au temps, à l’espace, aux personnes. Des phénomènes qui n’ont pas vocation à se manifester habituellement peuvent s’y exprimer, traduisant un état de conscience particulier aussi bien chez le consultant que chez le praticien. Chez le premier on le repère à des phases d’absence, de rupture du fil, à des mouvements régressifs voire des accès émotionnels, parfois explosifs. Chez le praticien, la modification de l’état de conscience se traduit par un état flottant, riche en sensations, en images, en manifestations corporelles, souvent qualifiées d’intuitions.
Ces manifestations témoignent de l’efficacité du cadre implicite pour ouvrir les portes du monde intérieur et accéder à l’inconscient. Trois brèves pour illustrer ces phénomènes.
VIGNETTES 5 et 6 : captations subliminales
Cristobal (en individuel), Alexis (en groupe), praticiens ;
Nicky et Nico leurs consultants
Cristobal me dit, en cours de séance et sans que je voie le lien avec ce qui précédait, « tiens il me revient qu’à la deuxième séance (ils en sont à la huitième) Nicky (sa consultante) m’a dit qu’elle hait ses parents. Bizarrement je n’ai pas cherché à creuser l’information, ni alors ni après. » Je lui demande ce qu’il ressent, « brut de décoffrage », quand il me rapporte ce fait. Euh… on ne va pas plus loin ! dit-il. Il avait très bien perçu l’injonction (l’intention) cachée dans le message sans se donner le temps de l’identifier et il y avait obéi, il n’a pas cherché à creuser.
Il ajoute, je lui ai dit la haine va toujours avec l’amour. Ça sent un peu trop son cliché, lui dis je en ajoutant que l’alliage en question ça fait de l’amour empoisonné. Il semble encaisser un coup puis enchaîne sur cette femme, séduisante, qui cherche l’amour et n’a que des échecs, et pourtant, dit-il, pour quelqu’un qui a faim (une expression pas très moralement correcte à l’heure de #metoo)… L’autre jour en fin de séance elle me donne la main et la laisse glisser sur la mienne… j’ai ressenti du dégoût. Il frissonne et se recule à cette sensation. Il sait ce qu’est le poison dans l’amour.
Quand revient à Cristobal, en séance de supervision, le on n’approche pas ! de Nicky je perçois qu’on est dans le présent. Quelque chose de difficile affleure que tente de cacher son cliché puis ressort : le dégoût. La sensation du dégoût lui appartient, c’est lui qui la ressent, comme lui appartient la « désirabilité » de Nicky mais elle est précieuse car elle donne à Cristobal une idée de l’univers relationnel de Nicky. Il vient de vivre ce que vivent les personnes dont cette femme désirable stimule le désir, un réflexe de retrait, ce dont elle se plaint dans sa vie, ignorant que le scénario en est inscrit en elle.
Cristobal capte beaucoup de choses non dites mais il peine à les accueillir dans l’ici et maintenant. Il perçoit sans en prendre conscience l’interdit posé sur la « haine » de Nicky envers ses parents. Il y obéit sans se questionner. Quand j’évoque l’amour empoisonné, je sens son ébranlement et il se permet alors de relier deux ressentis personnels, l’un comment il se sent (se sentirait ?) attiré par cette femme et comment le contact de sa main a fait monter une sensation de dégoût. Ce qui parle du monde intime de Nicky grâce à la résonance (que certains nommeront contre-transfert) personnelle de Cristobal.3
Alexis vient au groupe de supervision avec une interrogation qui nous trouble : « la thérapie peut-elle conduire mon consultant au suicide ? » Il s’inquiète pour Nico, le consultant qu’il n’a vu encore que deux fois. Que veut-il dire ? Nico est-il suicidaire ? Pas du tout, il n’en exprime rien et je ne le sens pas tel, dit Alexis. Ce qui l’amène au cabinet est un problème de relation amoureuse décevante, une fois de plus, dit-il.
Alexis ne peut rien dire sur son inquiétude incongrue, elle est là dans sa tête, nue, sans attaches. Mais quelque chose lui revient. Dès leur première rencontre, Nico a raconté une histoire terrible : son grand-père a égorgé un de ses fils, c’est-à-dire un des oncles de Nico, un frère de sa mère. Nous entendons le récit, une horreur nous traverse, nous bombardons Alexis de questions, que s’est-il passé, pourquoi, comment ? Etc. Nous avons quitté Nico, nous avons plongé dans ce passé, indifférents à ce qui a pu conduire Nico à amener cela dès ses premiers mots.
S’est-il passé la même chose entre Nico et Alexis, laissant la pensée mortelle se glisser dans sa pensée et aboutir à cette image terrible, d’un consultant conduit au suicide par son thérapeute parasité par une impulsion homicide. Certains suicides sont une mise à mort à distance, l’aboutissement d’une pulsion meurtrière parcourant l’histoire familiale, une pulsion homicide dormante qui un jour trouve le climat favorable à son accomplissement, par exemple un travail entrepris avec un thérapeute.
L’exemple d’Alexis illustre de façon troublante comment une information chemine et ce qu’elle produit. Le groupe est cueilli à froid par la question d’Alexis sur le danger de suicide qu’il ferait courir à un consultant. Comme s’il portait ce danger en lui. Il s’empresse de dire que rien n’en parle dans le discours de Nico. Et lui revient le récit de cet événement familial dramatique d’un père infanticide, le grand-père de Nico.
Le groupe s’émeut, tout à coup on questionne, on suppute, on veut savoir. On oublie comment le meurtre familial, dont tous les mythes regorgent, gardent cette puissance hypnotisante sur nous. Et on oublie la question initiale d’Alexis qui parle de l’effet immédiat du transfert faisant d’Alexis un des personnages de la mythologie familiale de Nico. On oublie qu’après avoir été des proies nous sommes devenus de redoutables prédateurs et que nous avons gardé les deux postures. Quel obscur cheminement dans nos inconscients suit le fil qui va du grand-père de Nico à la question d’Alexis ?
Cristobal et Alexis nous montrent comment ce qui s’actualise dans le cadre implicite est lié aux mouvements de l’inconscient. Là se situe le travail pour lequel le praticien est payé. Le cadre implicite est invisible en tant que dispositif sur lequel le praticien s’appuie pour se guider, être attentif aux phénomènes, accompagner le processus thérapeutique malgré les obstacles. Invisible car il n’a pas à être explicité au consultant. Il ne peut être nommé que quand l’inconscient se met à jour, pas avant. Sinon on est dans l’interprétation, jamais très loin de la prise de pouvoir par les mots.
Si on parle de contre-transfert, il faudra le voir comme positif si Cristobal peut le mettre au service du 3 processus thérapeutique ou négatif si au, contraire il passe au service de la résistance.
VIGNETTE 7 : une crise de larmes
Elvire, praticienne, Lise, consultante (en groupe)
Comment puis-je l’accompagner avec mon histoire, demande Elvire à propos de Lise, sa consultante à qui on vient de détecter un cancer du colon. Elvire est bouleversée par la nouvelle qui la replonge dans son histoire familiale, tant de cancers, tant de folie, tant de morts. Contre toute attente Lise accueille l’annonce dans la sérénité, c’est le printemps, une floraison dans sa vie, dit Elvire et elle a du mal à l’accepter. Ça va trop vite pour Lise dit-elle, faut lever le pied. Et elle part dans l’histoire de la naissance de Lise, elle connaît des protocoles de travail sur la venue au monde. Voyant comment elle évite l’ici et maintenant je hasarde en quoi elle te menace dans sa façon de vivre sa situation ? Silence. Et comme venue de nulle part explose une crise de larmes. Je l’accueille d’un il se passe quelque chose, oui, dit-elle, c’est la perte… La perte… (je la sens tenter de trouver une raison)…la perte de Lise, la peur de la perdre… L’explication vient trop vite, je laisse voir mon doute, l’ébranlement émotionnel se poursuit… je propose peut-être la perte, te séparer de… je pense furtivement à sa question initiale, la connexion se fait, la phrase se déroule, le coup qui la frappe est bien la perspective de se séparer, de perdre l’attachement à son roman familial.
Un phénomène imprévu vient témoigner qu’un processus se déroule, ici et maintenant, dans la profondeur, en lien avec la relation thérapeutique. Il n’obéit pas à la logique du raisonnement explicite, mais il fonctionne comme une phrase : un fil de sens reliant, comme des mots, des phénomènes psycho-corporels, des images, des émotions, des blancs, un silence. L’accueillir sans intention ni jugement est façon de laisser venir et se dérouler le fil jusqu’à ce qu’apparaisse l’ensemble de la phrase ou, mieux dit, la totalité d’une gestalt dont seule une partie s’est manifestée. C’est ce que permet le cadre implicite de l’ici et maintenant installé dans la bulle.
DANS L’ ICI ET MAINTENANT, UNE RELATION PARTICULIÈRE
Le consultant entre dans le cabinet avec le mal-être, la souffrance, le poison qui colorent ses relations avec autrui. Il le dit comme ça lui vient, il en ignore les sous couches et, bien qu’il ait, par définition, toute liberté de parole en ce lieu, son discours est saturé d’entraves et d’interdits. Tout ce qui se déroule dans le cabinet, dans cette bulle de temps, d’espace et de relation, tout ce qui s’y dit, s’y vit, s’y agit est lié à l’ici et maintenant d’une rencontre entièrement traversée par la puissance du transfert-contre transfert. Tout est là. En l’oubliant, on risque de sortir du cadre implicite, comme un chirurgien qui irait répondre au téléphone.
Le transfert-contre-transfert , phénomène puissant et totalement inconscient par 4 nature, modèle la relation entre le consultant et le psychothérapeute. Le consultant projette sur le praticien les figures importantes de son histoire, lui proposant en quelque sorte de prendre leur place. Le cadre implicite aide à percevoir les ressorts cachés des relations du consultant. Ainsi la mère ou le père qu’il voit dans le praticien ne sont pas seulement la mère idéale, bonne, le père attentif et protecteur, etc. comme certains praticiens le pensent, mais tout autant la mère intrusive, possessive, dépressive, le père violent, absent, infantile, c’est-à-dire les personnages importants de son roman familial. Le récit de sa vie se réfère à ce roman, même à travers ce qu’il croit être d’authentiques souvenirs. Le roman est la version officielle de son histoire, dictée par/ écrite pour les
Si le transfert est une notion assez claire, le contre-transfert est un terme équivoque, comme s’il 4 s’agissait d’un phénomène réactionnel, opposé au transfert. Il serait plus juste de parler de résonance comme deux émetteurs-récepteurs qui entrent en résonance, figures tutélaires écrasantes de son monde caché. C’est à ceux-là qu’il veut désespérément rester loyal (à son insu total) parce que ce sont ses parents.
En même temps qu’on entend le premier degré de ce qui se vit ici, on doit rester ouvert aux courants souterrains. C’est à la lumière du postulat de l’ici et maintenant relationnel que tout doit être entendu. Entendu, pas forcément, explicité, expliqué, asséné. Là se dévoile le caché, le non-dit, le tu, l’interdit de séjour dans la conscience. Rester disponible à l’autre scène, la scène où ça travaille, où se vit le danger, la terreur, où s’ancrent les forces aliénantes comme libératrices qui déterminent la personne, voilà ce qui définit l’écoute psychothérapique.
8° VIGNETTE : un ménage à trois
Personnages : Ginou la praticienne, Fanny la consultante, supervision individuelle À peine ouverte la porte du cabinet, Ginou sent quelque chose basculer en elle. Elle ne l’avait pas perçu au téléphone quand Fanny lui a demandé un rendez-vous, mais dès qu’elle la voit tout revient : elle a reçu Fanny et son compagnon en thérapie de couple quelques années avant. Et elle reçoit comme une claque ce qu’elle a alors ressenti, l’insupportable. Elle répètera le mot à plusieurs reprises. Cet homme intraitable, dominant, arrogant, qu’elle trouve maltraitant, voire sadique, avec sa compagne, cet homme, c’est tout ce que je n’aime pas chez un homme, dit-elle. Fanny explique sa démarche : « il paraît que c’est moi le problème, mon mari l’a dit, il a dit que je dois faire un travail sur moi. C’est pour ça que je viens. » Sans prendre le temps de savoir ce que le ça de Fanny peut signifier pour elle-même, Ginou lui dit qu’elle ne la croit pas : thérapeute, elle sait c’est pour elle-même qu’elle vient.
Mais ça est-ce faire comme son mari dit, lui obéir et lui complaire, ou pour entendre c’est lui le méchant, et, un pas de plus, pour entendre faisons alliance contre lui, quand on est venus vous voir j’ai bien vu que vous le trouviez insupportable. Ou vient-elle pour changer de maître moi je suis prête à vous obéir à vous, etc. Le message sous-jacent pourrait être : je me soumets à qui veut bien de moi, j’obéis à qui m’aime quelle que soit la façon dont il l’aime.
Toutes les options sont ouvertes, à condition de ne pas s’en tenir à son discours. Mais Ginou la devance et Fanny ne peut dérouler l’écheveau complexe de son âme, sait-elle seulement ce que serait prendre soin d’elle-même. Ginou a dit sa vérité sans attendre celle de Fanny.
En supervision, elle explique que, séance après séance, Fanny déroule sa plainte et ses pleurs, oh mon mari, il me maltraite, il n’est pas gentil, il est trop dur avec moi. Pour elle, le problème c’est lui, Ginou ne peut s’empêcher de penser de même, les mots se pressent dans sa gorge, mais quitte-le, fous-le dehors, elle ne peut pas le dire, elle est thérapeute, ça ne serait pas bien. Alors, je me tais, dit-elle. Mais la pensée est là, taraudante, que si Fanny le quittait le problème serait réglé, et contredit en sourdine ses mots d’accueil prétendant qu’elle sait que Fanny vient pour elle
même. Elle a quitté l’espace thérapeutique pour l’espace conjugal ou un autre espace professionnel. Les mots qu’elle retient dans sa gorge sont plutôt ceux d’une avocate qui conseillerait de partir avant qu’il soit trop tard. Ou d’une copine consolatrice, énervée de supporter les plaintes et les larmes de son amie et de lui avoir déjà dit cinquante fois de le quitter. Sans résultat. Ou d’un comportementaliste voici la procédure à suivre pour prendre la décision…
Elle dit ne pas croire les mots (le texte) d’introduction de Fanny, mais elle obéit à une des injonctions cachées du discours de Fanny, peut-être en écho à quelque chose venu de sa propre profondeur. Elle ne voit pas que Fanny, à son insu, tente d’installer avec elle, du fait du transfert, une relation identique à celle qu’elle entretient avec son mari et qu’en toute bonne foi, Ginou entre en rivalité avec lui. Elles ont réussi à créer un ménage à trois et l’ombre du compagnon occupe l’espace du cabinet. Quand Ginou avance à demi-mot qu’elle pourrait le quitter, Fanny se récrie, mais je l’aime il sait être si gentil faut pas croire ! Ginou se retient de crier sa colère contre lui et contre Fanny, elle lutte contre ces pensées et la violence qui les sous-tend. Elle ne voudrait pas y céder, l’image qu’elle y voit d’elle ne lui plaît pas. Elle n’est plus là, sortie du cadre non seulement de l’ici mais aussi du maintenant, basculée dans son passé. Fanny se retrouve seule. Je lui en fais la remarque. Subrepticement s’est mis en place le cadre implicite de la supervision. Ginou est prise dans un processus personnel qui l’entraîne loin dans son histoire. Elle dit d’un air malheureux mais je ne peux quand même pas lui dire ça. Ça, c’est-à-dire ? On est en supervision, elle y est pour voir plus clair et moi pour l’accompagner jusqu’où elle est prête à aller pour dénouer le noeud de vipères. Je sens les mouvements qui s’affrontent en elle, elle recule instinctivement, je vois passer dans ses yeux une onde de terreur fugace, des scènes de guerre, de la fureur et une sorte d’excitation trouble. J’entends l’écho répercuté en elle de l’insupportable si intensément éprouvé quand elle voyait le couple se déchirer, revenu quand Fanny entre dans son cabinet, puis quand elle se perd dans la plainte et les pleurs. L’ombre du mari résonne-t-elle avec une ombre similaire chez Ginou ? Clairement, en ce moment il s’agit de l’horreur remontée de son passé, des noeuds de souffrance si anciennement présents dans sa vie, causes d’échecs répétitifs dans sa vie sentimentale, affective, relationnelle. On en a souvent parlé. Va-t-elle pouvoir de nouveau y travailler grâce à/ pour/ avec Fanny ? Pour l’heure, elle se trouve loin de Fanny, loin de la thérapeute. Moment délicat en supervision quand, sans en sortir, on côtoie la psychothérapie.
Ginou a cru à l’arrivée de Fanny refuser le rôle qu’elle lui proposait, sans voir qu’elle l’endossait aussitôt, prise dans un point aveugle. Elle entre dans une situation identique à celle dont Fanny se plaint et elle s’en plaint : je me demande pourquoi je les ai acceptés. Dès que j’ai reçu le couple ça a été insupportable, et finalement je n’ai pas continué. Et pourquoi, quand j’ai compris que cette Fanny c’était cette femme et son mari cet homme, j’ai continué.
Le discours initial de Fanny a servi d’appât. Quand Fanny parle de son mari elle établit avec Ginou une relation dont aucune ne voit les ressorts.. S’en tenant aux mots, Ginou sort du cadre, de sa place de thérapeute, non pas parce qu’elle veut lui expliquer ce qu’est une thérapie mais parce que, ce faisant, elle ne prend pas garde à ce qui la meut elle-même, qu’elle prend la place du mari, l’introduit dans le cabinet et fait de Fanny leur objet.
Effet classique de l’ambivalence du transfert qui dirait « je fais de toi le partenaire de mes relations toxiques en même temps que la personne qui peut m’aider à m’en libérer ». Si elle continue le travail engagé avec Fanny, peut-être va-t-elle déjouer le piège.
Un mois après cette supervision, on se revoit. Ginou a revu Fanny trois fois depuis. Elle a donc continué. Surprise, dit Ginou les deux fois suivant la supervision il n’a pas été fait mention du mari. Quelque chose a dû se poser chez moi, j’ai pu accueillir tout ce qui se passait. Je me demande si elle ne m’a pas protégée de … de ma maltraitance envers elle. Phrase forte et lucide. Comme souvent après un travail intense en supervision ça a bougé et la séance suivant la supervision s’engage dans un climat différent. Quand Ginou a compris qu’elle était sortie du cadre psychothérapique, c’est-à-dire du cadre implicite, elle a pu le réintégrer, en comprendre les ressorts cachés et peut-être y accueillir Fanny sans a priori ni jugement. L’hypothèse est que ce travail a fait disparaître le mari du cabinet où Ginou l’avait invité pour un bras de fer, pour savoir qui dominerait Fanny et la maltraiterait…
Ce que dit le consultant, même quand il parle du passé, de l’extérieur, de ses autres relations, quel que soit le langage utilisé, les mots, la musique et ses dissonances, les émotions, les tremblements, les moments d’apnée, tout ce qui tente d’échapper aux systèmes de contrôle qui verrouillent le corps et la pensée, les gestes faits machinalement, une absence, une ombre d’effroi dans le regard, tout vient se projeter dans cet espace temporo-spatial pour mettre à jour l’écheveau relationnel dans lequel le consultant est pris et dont il n’est pas maître. C’est la magie du cadre caché de le rendre visible. Au praticien d’entendre et d’accueillir et pour cela de se retenir de comprendre ou d’expliquer.
DANS L’ICI ET MAINTENANT, DES ENCHAÎNEMENTS QUI SE RÉPÈTENT
Certains praticiens sont surpris par des comportements qu’ils trouvent peu logiques : un tel vient pour changer et se répètent les situations dont il se plaint. Celle-ci ne cesse de quitter un homme violent pour en retrouver un autre, qui s’avère très vite identique. Un jeune homme ne cesse d’enchaîner les formations et, malgré ses capacités, il ne va jamais au bout. Une telle se plaint rageusement de ses parents intrusifs et se trouve régulièrement dans une situation telle qu’ils doivent voler à son secours. Où est la logique de la répétition ?
L’insistance des situations de souffrance à se répéter est-elle seulement l’effet de la malchance, du karma ? Répond-elle à une de sorte de mécanismes intérieurs de la personne qui serviraient d’adaptation, de protection voire d’expression d’un besoin ? S’agit-il de la moins mauvaise façon de s’adapter à une situation et telle que la personne puisse en supporter le coût en termes de souffrance.
Ces mécanismes psychiques toujours présents sont constitutifs de la version officielle qui régit leur vie, leur roman. Le transfert a pour effet majeur de reproduire immanquablement dans la thérapie les relations dont le consultant souffre dans sa vie. Si le praticien reste collé au récit, croyant qu’il ne parle que de la vie quotidienne ou passée du consultant, il risque de ne pas voir qu’il endosse, bon gré mal gré, un des rôles de la relation toxique et qu’elle se répète avec lui. Le cadre implicite dévoile ici l’inconscient presque à livre ouvert.
Si Ginou peut voir comment elle endosse le rôle du mari que le scénario lui assigne et s’en décaler, elle déstabilise subtilement l’équilibre, précaire et coûteux, que ce type de relation assure à Fanny. Le porte-à-faux n’est vivable pour Fanny que parce que Ginou représente un autre personnage du transfert, celui sur qui s’appuie le mouvement qui a conduit Fanny en thérapie.
Ce jeu déroutant traduit l’ambivalence du consultant entre la tentation de faire sortir les praticiens du cadre pour préserver le statu quo et celle de se laisser porter par la dynamique du changement.
DANS L’ICI ET MAINTENANT, DES PASSIONS AMBIVALENTES
Si le consultant n’était pas pris devant le changement entre son désir et sa peur, il aurait changé par lui-même et n’aurait pas eu besoin de venir voir un tiers. Nous avons aussi été consultants. Nous savons notre ambivalence, les pieds qui traînent, l’envie d’arrêter, la nuit de nouveau après une éclaircie. L’ambivalence est reliée à des ressorts profonds de l’être qui dessinent un double mouvement. D’une part, un mouvement fait entreprendre la démarche qui tend à l’émancipation, à la libération des entraves – le processus d’individuation pour Jung, la tendance actualisante pour Rogers, la recherche du joint du sentiment le plus intime de la vie pour Lacan, le Wo Es war soll Ich werden de Freud, etc. Cette poussée leur fait créditer le praticien du pouvoir d’opérer les changements profonds dont ils vont prendre conscience au cours de la thérapie.
D’autre part, s’y opposant autant qu’il peut, nous connaissons le mouvement qualifié de résistance, de défense. Il est lui-même double : d’une part il réactive les défenses mises en place très tôt pour assurer la survie, d’autre part il relaie la dynamique des loyautés aux liens parentaux ainsi qu’à la mythologie familiale, préservant les liens au groupe, quels qu’ils soient. Ce système complexe et puissant d’adaptation représente tout ce à quoi le consultant, qui ne le sait pas encore, devra renoncer.
Qu’il s’oppose, contestant les exercices, ou qu’il se soumette, les faisant par pure complaisance il propose une relation de pouvoir. A voir si le praticien va prendre. Une séance semble avoir fait franchir une étape et, la fois suivante, rien ne va plus, tout est oublié. Ça ronronne, ça ne bouge pas, faut-il continuer ? Ces tentatives de neutraliser le praticien, de le mettre en difficulté échappent à la volonté du consultant et parlent autant de résistance que de protection.
L’ambivalence joue sur les deux tableaux. Etre la personne importante dans une relation, être confrontée à sa valeur comme être humain est peut-être ce qui est le plus confrontant et le plus difficile à vivre pour le consultant. Pas facile d’accepter d’être une personne de valeur, qui a droit à soi-même quand on s’est pensé de toujours le malaimé, l’invisible, le loser qui ne recevrait de valeur que d’apparaître ainsi. À qui doit rester fidèle au malheur et aux personnes qui y sont liées le bonheur est parfois une insulte ou un parjure. Déchiré entre l’importance qu’il se donne en venant en thérapie et la peur de perdre les relations primordiales de l’enfant qu’il a été, le consultant est dans la confusion et y plonge le praticien car l’attachement et la loyauté se cachent derrière un discours de plainte, de ressentiment contre les parents, leur dureté, leur négligence, leurs coups.
Il est tentant de détourner l’attention du psychothérapeute en touchant ses points sensibles pour qu’il s’intéresse à quelqu’un d’autre, qu’il bascule dans sa propre souffrance et ne puisse entendre l’ambivalence faite de l’attachement viscéral aux parents et à leur amour, même empoisonné et tordu, et de l’amour de soi tendu vers l’individuation mais toujours suspect de trahison. Quand le consultant parle de ses parents et de lui-même, il est toujours dans cette ambivalence, amour et trahison. C’est à résoudre cette quadrature du lien que le praticien l’accompagne.
DANS L’ICI ET MAINTENANT LA NEUTRALITÉ BIENVEILLANTE
Dans ce contexte, ce qui depuis Freud est appelé neutralité bienveillante est un allié précieux du praticien. La méconnaissance du cadre implicite rend parfois difficile de comprendre le concept car elle empêche de voir l’ambivalence et de quel côté se portent la neutralité comme la bienveillance.
Il s’agit de ne pas prendre parti, ne pas s’identifier, ne pas se précipiter, ne pas chercher l’alliance (comme certains disent) tout en restant bienveillant. Être bienveillant c’est tolérer l’ambivalence, c’est être patient vis-à-vis du consultant qui « résiste » et confiant dans la partie qui a relevé le défi majeur de changer sa vie au risque d’être déloyal et traître. Être neutre et bienveillant, c’est être bienveillant d’abord envers la personne qui entreprend ce chemin difficile, bienveillant au processus thérapeutique, quitte parfois à être moins conciliant avec le personnage et pas dupe des fausses pistes ni de ce que chantent les Sirènes. Pas toujours facile. L’alliance repose sur une confiance profonde dans les ressources de la personne, au-delà de la sympathie ou de la bonne entente. Bien des praticiens ont cru avoir établi une alliance avec leur consultant pour s’apercevoir, mais un peu tard, qu’ils étaient plutôt dans une compromission, un arrangement. On l’a vu avec Noël et Toussaint. Certains oublient parfois le défi crucial que représente pour leurs consultants la perspective de changements et de remaniements profonds dans leur vie autant qu’ils oublient les ressources dont ils disposent pour y parvenir. Elles leur ont permis de traverser tant d’épreuves jusqu’au jour de leur rencontre qu’il importe de les en créditer à l’avance, pour le jour où ils y auront accès. Ils viennent de loin, mais ils ont pu arriver jusqu’ici. Va-t-on les renvoyer dans ce passé et les réduire à l’enfant impuissant ?
LES SORTIES DU CADRE IMPLICITE (OU CACHÉ)
LA MÉTAPHORE D’ULYSSE.
Le voyage d’Ulysse est apparu dans d’autres Leçons comme une métaphore de l’entreprise psychothérapique. La métaphore a ses limites mais elle permet d’éclairer certains aspects du cadre implicite. Le praticien est à la fois les marins et Ulysse. Les marins, prêts à répondre au chant des Sirènes et à quitter le navire, à sortir du cadre, il faut les empêcher d’entendre le chant, qu’ils puissent fournir l’énergie du mouvement. Quant à Ulysse, il doit entendre le chant pour garder conscience du danger, rester à sa place et diriger la manœuvre.
Les Sirènes de la mythologie ne tendent pas leur piège pour le plaisir ou par méchanceté. Suite à de graves transgressions de leurs ancêtres, elles n’ont d’autre choix que de se conduire ainsi. Si elles y manquent elles périssent. Pas plus qu’elles, le consultant n’est fautif du piège tendu au thérapeute. Il le fait pour rester en vie et obéir à ses mythes, recourant aux moyens que son instinct trouve pour neutraliser celui qui menace sa construction et ses ancêtres et le détourner du projet pour lequel il a lui-même embarqué – arriver chez lui – ce qu’il craint autant qu’il le désire. Ulysse est absent de chez lui depuis dix ans, nos consultants depuis bien plus longtemps. Il n’y a pas de manipulation consciente, même si le praticien et a fortiori les partenaires du consultant le perçoivent ainsi. Le thérapeute éjecté, plus de risque d’affronter les démons , les 5 séparations, l’inconnu. Le cycle des répétitions et des plaintes peut reprendre.
Chacun a ses points aveugles, ses lignes de faille enfouies susceptibles, si la Sirène chante la bonne mélodie, de l’entraîner hors du cadre thérapeutique. Noël et Véra se sont laissé séduire par la vie et les activités sociales de Toussaint et d’Amandine. Ginou est emportée par un raz-de-marée passionnel, l’insupportable, la colère, Cristobal ressent un interdit de penser puis du dégoût, Edith est écrasée par le poids des épreuves contées par Blanche, Arielle (cf. Infra) est emportée par un mot savant dans un cours magistral et Alice (idem) par l’urgence de comprendre à tout prix.
L’histoire d’Ulysse illustre un mécanisme très habituel de sortie du cadre qui résulte de l’action conjointe et inconsciente des deux protagonistes. Mais parfois, souvent, le praticien s’éjecte de lui-même à la première occasion, pris dans ce que j’appelle un auto piège comme s’il craignait un accident et qu’il actionnait un airbag.
LES SORTIES DU CADRE
Les sorties du cadre implicite sont d’autant plus fréquentes qu’elles sont rarement perçues comme telles. Quelle qu’en soit la forme, toute sortie est d’abord une sortie de la relation actuelle. Le praticien peut aller dans le passé ou au-dehors, s’il continue d’être au contact de la relation actuelle, il reste à sa place.
La sortie porte en général sur plusieurs éléments du cadre en même temps. Parfois on peut repérer la caractéristique du cadre implicite oubliée, méconnue ou transgressée. On l’a vu avec Véra (vignette n°2) ou Ginou (vignette n°7) quand la praticienne sort de l’ici pour aller dans l’espace conjugal ou social du consultant ou, inversement, quand elle y introduit une des personnes de l’extérieur, reléguant à l’écart la personne venue à son rendez-vous. Situation fréquente car le consultant s’accompagne des personnes avec qui il vit une relation douloureuse ou veut emmener le praticien dans son quotidien difficile. La sortie du cadre temporel est très fréquente. Elle est liée à la sensibilité du praticien à certains appels comme, grand classique, le chant sirénien psalmodiant la souffrance enfantine est un grand classique. Quand la consultante parle des abus subis pendant l’enfance, la mère mal-aimante, le père violent, le praticien, bouleversé par le récit ,voudrait consoler l’enfant traumatisé, réparer ses blessures, lui montrer qu’il sait ce que c’est. Emporté émotionnellement dans l’enfance de sa consultante, revivant peut-être la trouble et intense souffrance victimaire, il est sorti du cadre. Belle tentative pour éviter peut-être de se séparer lui aussi de sa propre enfance. On l’a vu avec Alice et Édith (vignettes n° 3 et 4).
Le poète sait de quoi il retourne en vrai : « nos terreurs sont des dragons qui gardent nos trésors les plus 5 précieux. » (R.M. Rilke).
Les Sirènes savent jouer aussi des mots pour titiller l’intellect des gens instruits et les emporter hors de… maintenant.
VIGNETTE n°9 le piège du savoir académique
Arielle, praticienne, Noémie, la consultante ; groupe
Dans un groupe de supervision Arielle, entrant lentement dans un espace intérieur régressif à partir du travail qu’elle fait avec Noémie, prononce le mot d’archaïque. Une seconde et le mental reprend la main : Arielle se met à exposer ce que Noémie a pu vivre nourrisson. Le mot d’archaïque qui lui est venu à l’esprit a fait surgir les théories sur le développement de l’enfant, de ses pulsions. Elle bascule dans le passé, tente de trouver la cause du mal-être, se met à expliquer, à tresser les hypothèses savantes. On a perdu Noémie alors qu’il s’agit ici et maintenant d’être en contact avec cet espace, certes archaïque, mais toujours présent et actif dans les sous-sols de sa conscience.
C’est un travail dans l’ici et maintenant qui s’effectue et non pas dans le passé historique recomposé de Noémie, mais pour les psys, c’est bien connu, tout s’explique par l’enfance malheureuse aussi sûrement que pour les neurosciences c’est affaire de neurones et de réseaux informatiques. Peu de praticiens résistent au réflexe de chercher les causes venues de l’enfance pour expliquer le présent, peut-être pour masquer l’angoisse, la souffrance, l’incompréhension que le consultant suscite. Partis dans l’enfance, ils basculent dans le savoir et/ou l’impuissance (cf. Vignette n°4, Édith).
COMMENT S’ÉJECTER SOI–MÊME DU FAUTEUIL
Certains praticiens n’ont pas besoin d’entendre chanter les Sirènes pour sortir du cadre ou l’oublier, ils y vont d’eux-mêmes. Un thérapeute nomme cela mon travers, il se connaît et il a du mal à s’empêcher d’aller où le mène cette propension forte à vouloir pour l’autre, vouloir comprendre, expliquer, sauver, réparer, juger, se juger, etc. C’est toujours, en toute bonne foi et en parfaite inconscience, un piège que le praticien se tend à lui-même en permanence, amorcé de tout temps, prêt à se déclencher dès que se présente l’occasion d’agir. Il ne s’y voit pas tomber… puisque c’est pour le bien de l’autre.
Se laisser hypnotiser par le récit …
Le consultant donne des informations sur son histoire, ses raisons de venir, le praticien croit qu’elle sont importantes pour la suite mais on surestime toujours la vérité biographique du récit porté par le consultant, l’expérience de la psychothérapie le confirme chaque jour. La mémoire est un outil peu fiable quand il s’agit de sa propre histoire : elle est au service des croyances, elle a aidé à bâtir le roman explicatif qui sert à 6 vivre le moins mal possible. Le consultant y croit et nous sommes prêts à y croire, contre toute logique puisque, par sa démarche, il entreprend un travail qui va l’amener à déconstruire le mythe mémoriel.
Le récit est un piège puissant pour faire sortir le praticien du cadre, on l’a vu à plusieurs reprises (cf. Noël, Cristobal, Alexis, Ginou). Il est moins important pour les informations que pour les mots qui viennent, le langage non-verbal qui les accompagne et ce qu’il induit chez le praticien. Il dit beaucoup à condition de ne pas le prendre pour un récit mais pour un discours qui prend place dans l’ici et maintenant d’une relation. Il est précieux pour ce qu’il laisse voir des forces qui dirigent et organisent la vie de la personne. L’immersion dans la bulle et le phénomène du transfert-contre-transfert mobilisent si bien ces forces, transformant la bulle en chaudron, que le récit devient le vecteur d’émotions et d’intentions intimement liées au roman personnel et familial et destinées au praticien.
Quand le consultant parle des mauvais traitements subis pendant son enfance, que dit-il au praticien ? Cherche-t-il (je suis un enfant, une victime on m’a fait du mal) à désarmer son agressivité ou (je n’ai jamais été aimée) à l’inciter à le consoler, à le plaindre, ou (chaque fois c’est pareil, je rencontre un homme-une femme, et il/elle est violent, maltraitant/e, volage) à le chatouiller là où il serait justicier ou… pervers ? Ici et maintenant à qui parle le consultant ? À un personnage de son histoire, réel ou imaginaire ? À quelqu’un qu’on paie pour suturer les âmes décousues le temps que l’âme accède à ses ressources pour se réparer elle-même ? Sorti du cadre, hypnotisé par un récit dramatique, privant le consultant de son écoute, le praticien serait en peine d’y réfléchir.
6 Aragon a intitulé Le Mentir-vrai une nouvelle où il évoque son enfance…
Ce qui rend le praticien si hammeçonnable par le récit c’est sa croyance qu’il doit comprendre tout, bâtir une cohérence, trouver des raisons et surtout des causes. Pour lui ou pour son consultant ?
Comprendre ou percevoir ?
Comprendre, expliquer, juger … le trio infernal, comme le nomme une praticienne, menacent constamment le thérapeute. Ils sont pavés, comme tout enfer, des meilleures intentions.
L’homo sapiens renonce difficilement à comprendre et à expliquer. Le consultant tient à expliquer le pourquoi et le comment, il veut être sûr que le praticien le comprend bien. Louable intention. Mais à l’énergie qu’il y met on peut le soupçonner de vouloir contrôler la pensée du praticien et l’empêcher d’entendre autre chose que la version officielle. Nous avons tous un petit Poutine dans la tête.
Le praticien quant à lui s’épuise à vouloir suivre, comprendre. Désorienté, perdu, promené en tous sens, il court après un point de repère, comme s’il perdait tout ancrage. Il tente désespérément de trouver le fil, d’ordonner le chaos, d’apporter des réponses et plus ça va plus il se perd. Voulant garder le contrôle il ne se voit pas sortir du cadre. Il pense répondre au besoin du consultant de comprendre et s’adresse à son mental. Ce faisant il les éloigne tous les deux du mouvement qui a produit leur rencontre et dont les déterminants leur échappent, à l’un comme à l’autre. Ce qu’on nomme l’alliance se fait avec le mouvement, pas avec le mental.
Vouloir comprendre, expliquer sont des défis hasardeux car qui peut savoir ce que fut le passé et qui peut savoir ce que vit réellement l’autre. Défi hasardeux que de prendre le 7 risque d’être celui qui sait et défi pas tout à fait innocent. Chercher à expliquer, avec la meilleure volonté possible, n’est-ce pas tenter de pénétrer les défenses du consultant, limite intrusion, même s’il a assuré vouloir qu’on lui explique. Au mieux il se défendra, au pire il approuvera et même remerciera, pour se plier à notre pouvoir et se faire aimer enfin. Le praticien qui se met en position d’être celui qui sait apporte du pain bénit pour le consultant qui s’est toujours posé en opposition autant que pour celui qui a toujours voulu être le bon élève ou le benêt. Et vogue la complicité.
Le cadre invisible évite de se précipiter sur le récit du consultant, de le prendre au pied de la lettre, de lui répondre là où il oblige presque le praticien à dire, faire, penser quelque chose, et surtout comprendre et lui expliquer, mettant sa pensée sous pression. Pour se garder des réponses clés en main issues des manuels comme des interprétations dévitalisantes, la référence au cadre implicite est bienvenue. Elle oblige le praticien à rester attentif à l’expression corporelle : le corps est par nature dans l’ici et maintenant même s’il est activé ou réveillé par le rappel d’un fait ancien. Les mouvements inconscients du consultant s’actualisent dans le cabinet et on peut les accompagner, les faciliter, et mettre en veilleuse notre prétention à y comprendre quelque chose.
Chercher le sens ou le sens ? Le sens qui nourrit le mental ou le sens qui parle de direction ? L’expérience enseigne que le sens est à prendre au sens moteur : dans quel sens, quelle direction va le mouvement vivant. Est-il arrêté, figé, tourne-t-il comme l’âne tirant la noria, repasse-t-il toujours dans les même ornières ? On dit que le corps ne ment pas mais il trahit. Il colle aux croyances et aux schémas pulsionnels de la personne et leur obéit si aveuglément qu’il les trahit en les rendant visibles dans la bulle. Il traduit et trahit en temps réel ce que dit le consultant. Manifestant la terreur ou la sidération sans que le présent les justifie, il témoigne de leur poids dans la réalité intérieure du consultant ou au contraire, tandis que le récit s’enfonce dans la négativité, il le contredit en se montrant vivant, chaud, agité.
« On ne sait jamais ce que nous réserve le passé » F. Sagan. Une phrase particulièrement pertinente. 7
VIGNETTE n°10 voir les mains
Innocent, praticien, Colin, consultant, groupe
Innocent explique, à propos du travail qu’il fait avec Colin, qu’il ne cherche pas à être guidant avec lui. Le serait-il ? Ce disant, il tient ses mains serrées, les bras tendus en avant comme un qui tiendrait les rênes d’un cheval. J’attire son attention sur ses mains, sans un mot de plus. Elles tiennent… une corde… pour diriger, murmure-t-il comme à contre-coeur.
Ses paroles disent son intention compréhensive et attentive, ses mains trahissent une tendance profonde en lui à diriger, que son consultant va se faire un plaisir d’activer, pour s’y opposer ou s’y soumettre et piéger Innocent en l’emmenant là il ne veut pas être.
Faut faire quelque chose !
Les Sirènes ont toujours privilégié les chants compassionnels ou séducteurs à tonalité hypnotique pour amener le praticien à sortir lui-même du cadre. Parfois compassion et séduction sont tellement à l’affût chez le praticien qu’elles s’activent dès que pointe le sentiment d’une urgence à faire quelque chose, conseiller, sauver, empêcher le suicide, câliner, médicaliser, etc. Prendre la direction des opérations aboutit parfois à endosser un des rôles du scénario du consultant, remplacer la personne défaillante dont il se plaint, sauter dans le réel extérieur (cf. le ménage à trois de Ginou). Au risque même, parfois, de porter préjudice à un tiers.
Quand l’urgence à faire prend la pensée en otage, il est urgent de prendre son temps. Plus que jamais, revenir à l’ici et maintenant – quelle est l’urgence réelle, le danger réel ici et maintenant dans mon cabinet. À une praticienne sommée par son démon intérieur de voler au secours de sa consultante désespérée et m’interpelant d’un « tu comprends, elle se noie, faut faire quelque chose », je demande « il y a donc une piscine dans ton cabinet ? » Retour à l’ici et maintenant.
Certaines situations produisent des auto-jugements apparemment cohérents. Dépassé par la situation, le praticien resserre le noeud par le biais d’un auto-piège : il s’invalide en se traitant in petto d’illégitime, d’incompétent, d’imposteur, en s’offrant au passage le petit plaisir masochiste de l’auto-dévalorisation offert sur un plateau par la situation.
La question est honorable mais elle mérite comme tout ce qui survient ici d’être considérée à la lumière du cadre caché. Vient-elle résonner avec le roman personnel du praticien et le doute profond sur sa valeur et sa légitimité qui en constitue un des piliers ? En quoi cette résonance, qui rend le praticien « hameçonnable » par la sirène, fait-elle écho à l’ambivalence du consultant à aller plus avant, les rendant complices d’une sortie du cadre, par la peur, voire la terreur d’être confrontés, l’un et l’autre, à leur valeur intrinsèque ? Si le praticien accueille son auto-jugement au premier degré, en y croyant, une fois de plus, il s’éjecte lui-même de sa place sans se soucier de laisser son consultant tout seul.
Parfois le thérapeute transforme le piège dans lequel il est pris en une interrogation professionnelle technique : que dois-je faire maintenant, quel geste, quel protocole ? Ça ne peut pas attendre, il y a urgence – et nous retrouvons urgence et faire, les grands anesthésiants de la liberté de penser dans la bulle. C’est parfois en fin de supervision, après une longue exploration de la situation, que le praticien susurre au superviseur (sur l’air de cause toujours mon coco) « et alors, qu’est-ce que je fais maintenant ? »
Partager ce qu’on ressent prend souvent l’apparence d’un geste technique qu’on a appris et qu’on a vu faire. Le geste cache l’auto-piège quand il répond au désarroi du praticien qui se demande quoi faire, quoi dire et se raccroche au mantra « partage ce que tu ressens ». La bonne idée risque fort de répondre à l’urgence d’éviter le vide, le silence, la vacance et les espaces ainsi rendus accessibles. Partager peut-il être anodin ? Le praticien est un personnage dont on sous-estime l’importance aux yeux du consultant. On évalue mal l’impact de ses mots et l’incertitude sur ses intentions. Partager un ressenti intime peut frôler l’intention intrusive voire incestuelle pour des personnes que la vie a habituées à des gestes ambigus de la part des figures parentales.
L’urgence reste en toute circonstance, dans ce lieu, dans ce moment, de retrouver une présence attentive, de ramener le silence dans l’agitation intérieure. Il est urgent d’accueillir ce qu’on ressent, non pour le partager systématiquement mais pour laisser venir le reste de la phrase – langagière, psychomotrice, organique. Le ressenti qui nous vient est peut-être le premier mot d’une phrase encore inconnue, d’une gestalt émergeant de l’inconscient. En l’accueillant et en le laissant retentir en nous, va peut-être se dérouler le fil que commence à tirer quelque chose du consultant qui tente de se dire de lui à lui et qui ne peut se faire qu’en empruntant notre canal. L’important est de s’assurer que le canal est bien perméable, dégagé autant que possible de nos attentes, nos projections, nos intentions, de notre désir de contrôler voire de dominer, pour que le reste advienne.
Ce qui signifie en clair que le partage reste dans le cadre thérapeutique quand il est net de toute intention (faire parler, orienter) et qu’il ne vient pas soigner l’angoisse du praticien de ne pas savoir quoi faire, de se sentir démuni, impuissant, sauf à se dire démuni, impuissant, sans y mettre aucune nuance personnelle, car cela ne parle pas de lui.
Le silence et le vide restent les instruments les plus subtils et les plus puissants du psychothérapeute. Instruments exigeants qui ne peuvent s’approcher que par la pratique.
Les signaux inopportuns
La rencontre avec les consultants produit inévitablement des mouvements en nous, ce qui s’appelle le contre-transfert. Être submergé par des émotions, des souvenirs, des images qui prennent le contrôle, comme par un effet miroir, sont des effets de la rencontre entre l’inconscient du praticien et celui du consultant. On en a parlé abondamment jusqu’ici.
Ces points échappent à la conscience et à la volonté. Les empêcher de vibrer, de se manifester serait se couper du vivant en soi. Le lièvre sait qu’il est pris au piège quand le collet l’étrangle et le poisson quand il est tiré de l’eau. La valise que nous transportons dans notre vie est chargée de nos peines, nos rêves, nos illusions. Parfois elle nous alourdit, nous fatigue. Les signaux de sortie dont je parle ici correspondent à ces moments où tout à coup on en sent le poids dans notre vie, la douleur dans l’épaule, la respiration courte, l’envie de s’arrêter. Autant sentir ces signes est essentiel, autant il est important de s’assurer qu’on a laissé notre propre valise dehors. Seul compte le voyant qu’elle allume. Le poids qu’on sent tout à coup nous indique que le consultant porte une valise qu’il n’arrive pas à poser et le signal nous met en contact avec un des nœuds où est-il est pris.
Mais que faire de signaux parfois considérés comme inopportuns, d’autant qu’on peut difficilement les ignorer. Ainsi des manifestations neuro-végétatives, comme la somnolence ou le sommeil, les nausées, un péristaltisme intestinal dérangeant, des troubles respiratoires, oppression, apnée, quintes de toux, une envie d’uriner, une érection, etc. Manifestations non seulement inopportunes mais qui peuvent apparaître au praticien comme dérangeantes. Son premier réflexe est de penser qu’elles n’ont pas leur place dans ce lieu, qu’il faut essayer de les ignorer. Il en ressent de la honte, de la gêne, voire de la culpabilité. Elles sont peut-être étrangères à l’ici et maintenant mais il ne faut jamais négliger la possibilité qu’elles n’y soient pas étrangères.
L’expérience apprend à les reconnaître, elles viennent avec tel consultant, avec telle situation, n’étaient pas là avant la séance, disparaissent après celle-ci. Une manifestation fréquente et difficile à accueillir est la somnolence, voire le sommeil. Est-il sortie du cadre implicite plus indiscutable que celle-ci ? Façon plus radicale de dire je n’y suis pour personne mais l’activation des structures nerveuses correspondantes chez le praticien indique la profondeur du phénomène. Indique-t-il l’urgence à sortir de la situation pour une raison qui reste à élucider ? J’ai le souvenir d’une occasion où mon sommeil a permis en quelque sorte que la consultante contacte un mouvement profond de son âme. Comme si, éveillé, j’aurais empêché qu’elle se rencontre en ce lieu. Indique-t-il que le praticien est submergé par la situation et qu’il a perdu liberté de penser et d’agir ?
Ce sont autant de signaux indicateurs d’un risque de sortir du cadre pour le praticien. Les turbulences dans lesquelles il est pris sont d’une aide majeure pour le processus car elles disent que la vie circule dans cet espace. Loin de réprimer ou de censurer ses propres mouvements, ses difficultés, voire de s’en fustiger, le praticien se doit de les accueillir à la lumière du cadre implicite. Soit il s’en laisse invalider, disqualifier et éjecter, soit il accueille ces manifestations comme des coups de projecteur sur le monde du consultant qui l’aideront à accompagner le processus thérapeutique en cours au plus juste.
Et on retrouvera les mêmes tentations déjà vues d’expliquer, comprendre, juger, voire de partager le ressenti. C’est en entrant dans le phénomène neuro-végétatif lui-même, en lui laissant occuper l’espace psycho-corporel que se déroulera le fil de la phrase cachée.
Il y a psychothérapie et psychothérapie…
Tout accompagnement n’est pas une psychothérapie au sens strict. Certains débutants, soucieux de vraiment commencer, voudraient qu’on soit vite dans la profondeur, comme ils disent. Il ne suffit pas que la personne dise « je viens pour une thérapie » ou que quelqu’un le lui ait conseillé pour que le praticien soit tenu de l’entreprendre. Entre un praticien et un consultant, la psychothérapie n’est qu’une des options. La personne peut venir parler d’un problème sans que cela débouche sur une psychothérapie. On peut suivre quelqu’un en soutien, parfois longtemps, parfois uniquement. S’il s’agit de soutien, d’aide, d’accompagnement, le cadre implicite n’est pas le même et le contrat n’a qu’un contenu commercial mais, quel que soit le type d’accompagnement, l’important est que la parole du consultant trouve un espace de liberté et d’écoute.
Plusieurs entretiens sont parfois nécessaires pour voir si l’un et l’autre sont prêts à s’engager avant de sceller l’engagement par un contrat qui pourra alors comporter, en dehors des éléments commerciaux, des données plus spécifiques : durée de l’engagement, communication entre les séances, modalités d’arrêt. Parfois le contrat doit être aménagé selon les difficultés spécifiques de la personne.
Ces propositions valent pour les psychothérapies qui se fondent sur l’inconscient et sur le transfert-contre-transfert, quelles que soient leurs revendications d’originalité, psychanalyse freudienne, jungienne, psycho-organique, bioénergétique. Pour ma part la gestalt-thérapie de Perls, l’approche centrée sur la personne de Rogers y ont aussi leur place. En revanche, n’en font pas partie les thérapies dites cognitivo-comportementales, venues du behaviorisme de Skinner et des techniques de conditionnement. Ces approches sont capables comme les psychothérapie relationnelles du meilleur comme du pire et beaucoup de techniques d’éducation, de traitement, d’orthopédie mentale s’en s’inspirent avec la meilleure intention, comme souvent des praticiens relationnels sans savoir qu’ils le font. Mais si ces thérapies s’appuient sur le transfert et l’inconscient elles le font à l’insu du client, ce qui fait une grosse différence et peut servir d’appui à toutes sortes de manipulations.
L’approche que je présente ici de la psychothérapie résulte de mon expérience personnelle, comme psychiatre hospitalier, comme psychothérapeute libéral, comme superviseur et de mon parcours de patient en psychanalyse, thérapie primale, intégration posturale, thérapie émotionnelle. Aujourd’hui je peux dire… que je n’ai suivi aucune formation spécifique à la psychothérapie et que je n’ai jamais été supervisé, sinon par les exigences de l’écriture.